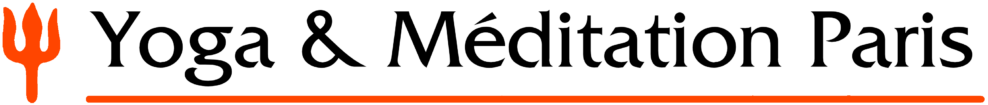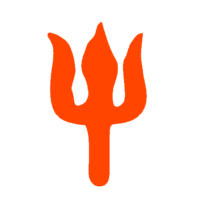Dictionnaire du yoga
Lorsque l’on commence le yoga, on découvre un véritable univers — avec ses propres mots, concepts, idées, lignées, maîtres et philosophies.
Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver, surtout si l’on souhaite vraiment comprendre ce que l’on pratique ou transmettre avec justesse.
Ce lexique du yoga a été conçu comme un outil de référence clair et accessible, pour tous ceux qui veulent aller plus loin : débutants curieux, pratiquants engagés ou professeurs de yoga.
Vous y trouverez plus de 150 définitions, concises et inspirantes, couvrant les grands concepts du yoga traditionnel, ainsi que des termes issus du tantra, du vedanta et du Hatha Yoga.
Ce n’est pas un glossaire à mémoriser — c’est un répertoire vivant, un guide de compréhension à consulter, relire et explorer à votre rythme.
Les termes sont classés par ordre alphabétique, avec des liens internes pour naviguer facilement entre les notions fondamentales du yoga.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
A
Acharya
Terme sanskrit désignant un maître ou enseignant respecté, dans un domaine spirituel ou savant. Un acharya incarne et transmet une tradition, que ce soit en yoga, en philosophie, en médecine ou dans d’autres savoirs.
Adi Shankaracharya
Sage, philosophe, ascète et yogi qui a réformé l’organisation de la spiritualité en Inde et formalisé le sannyasa dans l’ordre de dasnami. Adi Shankaracharya est un des plus grands personnages dans la spiritualité indienne.
Selon les chercheurs, sa vie est normalement datée à environ 700 après Jésus-Christ. Curieusement, dans la tradition vivante du yoga, on date sa naissance à exactement 509 avant Jésus-Christ, soit un écart de plus de 1000 ans.
Advaita (tantrique)
Vision spirituelle issue du tantra, notamment du shivaïsme du Cachemire, selon laquelle la conscience (Shiva) et l’énergie (Shakti) ne font qu’un. Contrairement à l’Advaita Vedanta, le monde n’est pas considéré comme illusoire, mais comme une expression directe du divin. L’éveil consiste à reconnaître l’unité vivante entre intérieur et extérieur, énergie et silence, matière et conscience.
Advaita vedanta
Advaita veut littéralement dire « non-dualité ». École philosophique fondée par Adi Shankaracharya, issue du Vedanta. Bien que l’ensemble du Vedanta enseigne que atman (le soi individuel) et brahman (la conscience absolue) sont liés, l’Advaita Vedanta pousse cette intuition à son extrême : il affirme que seul brahman est réel, et que toute forme de dualité — y compris celle entre sujet et objet — est illusion (maya).
Le monde phénoménal est perçu comme transitoire et irréel en soi. La libération (moksha) survient par une connaissance directe de cette non-dualité absolue.
L’Advaita Vedanta est aussi la philosophie centrale de l’ordre des dix noms (Dasnami Sampradaya).
Agnisar
Pratique de hatha yoga où le ventre est déplacé de l’avant en arrière. Agni veut dire feu, dans ce cas, il s’agit d’une référence au feu de la digestion.
Ahamkara
Littéralement « le faiseur de je ». Dans la philosophie du yoga et du Samkhya, ahamkara désigne le principe d’individuation : c’est la fonction mentale qui s’approprie l’expérience et crée l’idée du « moi ». Il est à l’origine de l’identification au corps, aux pensées et aux rôles sociaux. Sur le chemin du yoga, l’ahamkara est progressivement transcendé pour laisser place à la conscience pure (purusha).
Mots reliés : chitta, manas, buddhi, purusha
Ahimsa
Principe fondamental de non-violence, présent dans la plupart des traditions spirituelles de l’Inde. Il implique de ne pas nuire à autrui, que ce soit par les actes, les paroles ou les pensées. Ahimsa est à la fois une discipline éthique et une voie de transformation intérieure.
Mots reliés : yama, satya, karma yoga
Ajapa japa
Quand la récitation d’un mantra, japa, devient spontanée, cela s’appelle ajapa japa, répétition non répétée.
Dans le système du yoga de Swami Satyanada, ajapa japa est un kriya élémentaire à base de méditation avec un mantra comme support et d’ujjayi pranayama.
Ajna chakra
Chakra situé au milieu de la tête. Ajna signifiant « commande », ce chakra est le centre de commande des autres chakras.
Akhara
Dans la spiritualité indienne, un akhara est une organisation ascétique structurée, regroupant des sannyasins et yogis. Les akharas fonctionnent en parallèle aux ordres classiques comme celui des Dasnami de Shankaracharya, mais aussi à d’autres lignées telles que les Natha yogis ou les Aghoris.
Aujourd’hui, leur rôle est principalement pratique et institutionnel : ils organisent la vie quotidienne, les retraites, les rituels collectifs et la hiérarchie interne des renonçants. Leur fonction est donc essentiellement organisationnelle, plutôt que doctrinale ou philosophique.
Le mot akhara, qui signifie à l’origine « arène » ou « champ d’entraînement », symbolise le combat spirituel du yogi pour dépasser l’ignorance et atteindre la vérité.
Akshar
Akshar veut dire indestructible, il est utilisé pour designer le concept de syllabe, une parole qui ne peut pas être réduite.
Amrit
Le nectar d’immortalité.
Dans le hatha yoga on considère que des gouttes d’amrit tombent de bindu visarga à manipur chakra où elles sont consommées par le feu de la digestion. Ce processus est la raison du vieillissement physique du corps.
En pratiquant certaines méthodes de yoga, le flux d’amrit peut être redirigé pour utiliser ses qualités dans d’autres chakras et pour éviter de vieillir. Amrit peut se manifester par un gout sucré dans la bouche pendant la méditation.
Dans le yoga orthodoxe, amrit a un sens plus global. C’est l’essence à travers laquelle la vérité est révélée, au delà de la mort et la vie, au delà des opposés.
Anahat chakra
Chakra situé dans la colonne vertébrale derrière le cœur.
Ananda
Quand la conscience s’arrête de s’identifier avec les formes qu’elle prend, quand elle devient consciente d’elle même, l’expérience est alors accompagnée d’une félicité, d’une joie au delà de toute joie – C’est l’ananda.
Ardha
Préfixe sanskrit signifiant « moitié » ou « partiel ». Employé dans de nombreux noms de postures de yoga (asanas) pour désigner une forme réduite ou simplifiée, comme Ardha Chandrasana (demi-lune) ou Ardha Matsyendrasana (demi-torsion spinale).
Asana
En général, dans le yoga moderne, un asana veut dire une posture de yoga. Cependant, à l’origine l’asana était le siège du yogi, souvent la peau d’un tigre.
Probablement, dans le yoga ancestral, les premières postures étaient des postures que les yogis employaient dans leurs rituels magiques d’invocation. Quelques siècles avant jésus christ, dans le Yoga Sutras, Patanjali a défini un asana comme une posture de méditation confortable et stable, essentielle pour samadhi.
A l’époque médiévale, le hatha yoga étant devenu un système élaboré, le mot asana conserve principalement ce sens, mais, désigne également d’autres postures statiques. A présent, dans le yoga moderne, le mot asana a évolué pour couvrir l’ensemble des postures et mouvements.
Dans le hatha yoga traditionnel, les asanas jouent un rôle important pour la préparation du corps et de l’esprit pour la méditation.
En Inde, le mot asana est aussi utilisé pour désigner un tapis de yoga.
Ashram
Ermitage spirituel dédié à la pratique du yoga, souvent placé sous la direction d’un maître.
Traditionnellement situé dans un environnement naturel, loin de l’agitation du monde, l’ashram offre un cadre favorable au recueillement, à la discipline et à la vie simple. Toutefois, certains ashrams peuvent aussi exister en milieu urbain.
Dans le yoga moderne, un ashram est souvent un lieu de retraite où l’on peut approfondir une pratique intense, parfois difficile à intégrer dans le rythme de la vie quotidienne. Il permet de s’immerger dans une sadhana (discipline spirituelle) soutenue.
Ashtanga yoga
Traditionnellement l’ashtanga yoga est le yoga décrit par le sage Patanjali dans les Yoga Sutras. C’est un yoga comprenant huit étapes, le yoga des huit membres : yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi ; d’où le nom ashta (huit) anga (membre).
En pratique, l’ashtanga yoga vise à arrêter les modifications mentales (les vrittis) afin de se mettre dans un état d’esprit où la vraie nature du « Soi » devient visible, samadhi. A travers les sept membres précédents, les obstacles de ce processus sont enlevés.
Attention ! Ne pas confondre avec l’ashtanga yoga de Sri Pattabi Jois, qui est une version dynamique de yoga postural moderne, populaire en occident.
Mot relié : yoga classique
Atma
Selon vedanta, Brahma est la conscience omniprésente indifférente qui inclut tout. L’atma est la conscience individuelle de l’homme, une composante de Brahma. Le but du yoga est de rompre avec l’idée de séparation, pour se réunir avec Brahma.
Avidya
L’ignorance. Ce qui cache la vérité.
B
Baba
Enseignant, yogi et guru, dans certaines lignées de la tradition de sannyasa. Baba veut aussi dire père ou grand-père. En s’adressant à un baba, souvent le suffixe « ji » est ajouté à la fin pour montrer de la révérence, « babaji ».
Bandha
Un bandha est un verrouillage énergétique, souvent utilisé en combinaison avec un pranayama ou un mudra.
Il en existe trois :
Jalandhara bandha (le verrouillage du menton)
Uddiyana bandha (le verrouillage du ventre)
Mula bandha (le verrouillage de la racine).
Les bandha constituent un élément important du hatha yoga.
Bhagavad Gita
Texte fondamental du yoga et de la spiritualité indienne. La Gita prend la forme d’un dialogue entre Arjuna, guerrier tourmenté, et Krishna, son guide divin. Elle expose différentes voies du yoga — action (karma yoga), connaissance (jnana yoga) et dévotion (bhakti yoga) — dans une perspective unifiée.
Composée entre le IVᵉ siècle av. J.-C. et le IIᵉ siècle apr. J.-C., la Gita est considérée comme un texte de synthèse entre la sagesse védique et les voies pratiques du yoga.
Bhajan
Chanson dévotionnelle. Similaire au kirtan mais moins répétitive et souvent avec des paroles plus élaborées.
Bhakti yoga
Le yoga de la dévotion. Bhakti yoga s’exprime par exemple par des kirtans ou des offrandes faites aux personnalités de la nature et de l’univers.
Bindu visarga
Chakra qui se situe sur le sommet de l’arrière de la tête. Source d’amrit et lieu où les nadas (sons psychiques) se manifestent.
Brahma
Selon vedanta, Brahma est la conscience suprême sans formes et sans limites. En tant que Brahma, tout fait partie d’un même tout.
Brahmacharya
Discipline de vie orientée vers la réalisation spirituelle. Le mot signifie littéralement « conduite dans Brahman » — vivre en accord avec la réalité suprême. Dans la pratique, il désigne la maîtrise des désirs, souvent associée à la modération sexuelle, mais plus largement à un mode de vie centré sur la quête intérieure.
Mots reliés : yama, tapasya, vairagya, moksha
Buddhi
Dans la philosophie du yoga et du Samkhya, buddhi désigne l’intelligence supérieure, ou faculté de discernement. C’est la partie du mental qui peut voir clairement, décider, et reconnaître la vérité. Contrairement à manas (le mental réactif), buddhi est associée à la lucidité, au choix conscient et à la capacité de se détacher des conditionnements.
Mots reliés : chitta, ahamkara, viveka
C
Chakra
Chakra est un mot sanskrit qui signifie « roue » ou « cercle ».
Les chakras était au départ des supports de visualisation qui aide à se mettre en contact avec les couches subtils du corps humain.
Les principaux chakras se situent physiquement dans la colonne vertébrale, au croisement de trois grands nadis : sushumna, ida et pingala nadi. Dans la tradition indienne, les chakras sont symbolisés par des fleurs de lotus. Chaque pétale représente un des canaux énergétiques connectés au chakra. La lettre sanskrite correspondant à la vibration du nadi est inscrite sur chaque pétale.
Le nombre de chakras varie selon les traditions. On compte d’habitude six ou sept chakras principaux, auxquels viennent se rajouter des chakras mineurs. On considère généralement muladhara comme le chakra du bas, et sahasrara comme celui du haut, mais selon certaines écritures, il existerait des chakras au-dessous de muladhara et d’autres au-dessus de sahasrara.
Chela
Terme sanskrit désignant un disciple engagé auprès d’un guru. Le chela ne se contente pas de recevoir des enseignements : il s’inscrit dans une relation vivante de guidance, de confiance et d’apprentissage profond. Ce lien maître–disciple joue un rôle central dans de nombreuses traditions yogiques et spirituelles de l’Inde.
Mot relié : shishya
Chitta
Terme sanskrit désignant la substance mentale, ou l’ensemble des processus de conscience dans la philosophie du yoga. Chitta inclut la mémoire, les pensées, les émotions, les impressions (samskara), et les tendances inconscientes.
D
Darshan
Expérience de présence ou de vision directe d’un maître spirituel, d’une divinité ou d’un symbole sacré. Recevoir le darshan, c’est entrer en contact avec une réalité spirituelle vivante, souvent à travers un regard, une image (murti) ou la rencontre physique d’un guru. Cet instant est perçu comme une bénédiction transformante dans la tradition indienne.
Dasnami sampradaya
Littéralement l’ordre des dix noms. C’est l’ordre des sannyasis établit par Adi Shankaracharya, chaque nom étant un ordre en lui même.
Les dix noms sont : Aranya, Ashrama, Bharati, Giri, Parvata, Puri, Saraswati, Sagara, Tirtha et Vana.
Devanagari
La Devanagari est un système d’écriture alphasyllabique utilisé pour transcrire le sanskrit ainsi que plusieurs langues modernes du sous-continent indien, notamment le hindi, le marathi et le népalais.
Le terme signifie littéralement « écriture de la cité divine » ou « écriture sacrée ».
Elle se compose de signes représentant des syllabes complètes, organisées autour d’un schéma vocalique inhérent. Chaque consonne porte implicitement la voyelle a, modifiable par des signes diacritiques. L’écriture se lit de gauche à droite et se reconnaît à sa ligne horizontale supérieure caractéristique.
Dans certaines traditions spirituelles, notamment tantriques, les lettres sont perçues comme des manifestations de la conscience. On dit alors que les dieux résident dans les syllabes : chaque lettre est une shakti, une énergie divine féminine.
La Devanagari devient ainsi non seulement un moyen de transcription, mais aussi un véhicule de méditation et de révélation.
Dharana
La concentration profonde. Fixation stable de l’attention sur un seul objet.
Dharma
Principe d’ordre, de justesse et de conduite juste qui soutient l’harmonie du monde et de l’individu. Le dharma peut désigner la loi universelle, le devoir personnel, ou le chemin juste selon son âge, sa situation et sa quête spirituelle. Dans le yoga, suivre son dharma signifie vivre en accord avec sa nature profonde et ses responsabilités.
Dhyana
Terme sanskrit désignant, dans la culture indienne, la méditation au sens large.
Selon les traditions, dhyana peut désigner une pratique spécifique, un état de stabilité intérieure, ou une étape du chemin yogique.
Dhyana yoga
Le yoga de la méditation. Terme parfois utilisé pour désigner une voie de réalisation intérieure fondée sur la concentration et l’attention continue. Il est aujourd’hui rarement employé comme nom de tradition à part entière.
Dvesha
Répulsion envers les expériences perçues comme négatives, douloureuses ou menaçantes. Un des cinq kleshas (obstacles mentaux) identifiés dans le Yoga de Patanjali, mais présents sous différentes formes dans d’autres traditions spirituelles indiennes, comme le bouddhisme ou le Vedanta. Né de la mémoire de la souffrance, dvesha alimente l’évitement et la rigidité mentale, entravant la clarté intérieure et la liberté du regard.
G
Gorakhnath
Yogi médiéval de la tradition des Naths, également connu sous le nom de Goraksha.
Actif entre les XIᵉ et XIIᵉ siècles, il est considéré comme l’un des maîtres fondateurs du hatha yoga. Plusieurs textes sanskrits et vernaculaires lui sont attribués, bien que son image ait été largement mythifiée au fil des siècles.
Granti
Nœuds ou blocages énergétiques qui, selon le hatha yoga, entravent la libre circulation du prana dans le corps subtil.
Il en existerait trois principaux, situés le long du sushumna nadi, que le yogi doit dissoudre pour permettre l’ascension de la kundalini :
– Brahma granti, au niveau du bassin
– Vishnu granti, au niveau du cœur
– Rudra granti, au niveau de la tête
Ces « nœuds » représentent à la fois des blocages énergétiques et des attachements psychiques profonds, et leur dépassement est essentiel dans les pratiques avancées du yoga.
Guru
Dans la tradition du yoga et du sannyasa, le guru est celui qui a la capacité de guider une recherche spirituelle authentique. Plus qu’un simple enseignant, le guru représente une véritable institution spirituelle dans la culture indienne, au cœur de la transmission des savoirs intérieurs depuis des siècles.
Étymologiquement, gu signifie « obscurité » et ru, « lumière » : le guru est donc celui qui dissipe l’obscurité de l’ignorance et révèle la lumière de la connaissance.
Lorsqu’un guru accepte un disciple, il assume la responsabilité de son cheminement spirituel. Il donne son accord pour transmettre son savoir et s’engage à faire de son mieux pour éveiller le disciple à une vie intérieure — tâche exigeante et subtile.
De son côté, le disciple s’engage à dépasser ses aspirations personnelles, à faire preuve de confiance, et à reconnaître l’autorité spirituelle du guru dans le cadre de cette relation.
Mot relié : acharya
Guru Dattatreya
Figure mythologique, symbole vivant et incarnation des origines du yoga.
Maître de l’ensemble du savoir divin, il est représenté avec trois têtes, celles de Brahma, Vishnu et Shiva, incarnant la totalité des forces de création, de préservation et de destruction.
Gyani
Personne qui connaît la vérité ultime, non pas seulement de façon intellectuelle, mais par expérience directe. Un gyani est capable de reconnaître la réalité telle qu’elle est et de l’exprimer avec clarté, souvent à travers l’enseignement ou le dialogue.
Ce terme est souvent utilisé dans les traditions non-duelles comme le Vedanta, pour désigner un sage réalisé.
H
Hatha yoga
Le mot hatha apparaît pour la première fois dans un texte sanskrit au XIe siècle. Il signifie littéralement « force » ou « effort soutenu ».
Le hatha yoga est la première voie du yoga à avoir intégré des pratiques physiques systématiques, notamment les mudras, bandhas et pranayamas, dans un but d’éveil énergétique.
Pour en savoir plus : lisez notre article blog compréhensif sur le hatha yoga.
Hatha yoga kriya
Les processus de purification physique dans le Hatha Yoga, appelés shatkarma, sont parfois désignés sous le nom de hatha yoga kriyas.
À ne pas confondre avec les kriya de la kundalini.
Hatha yoga pradipika
Le Hatha Yoga Pradipika, rédigé au XVe siècle par le yogi Svatmarama, est un texte fondamental du Hatha Yoga. L’un des manuels de yoga les plus connus aujourd’hui, il compile des enseignements issus de plusieurs traditions yogiques, structurant des pratiques telles que les asanas, le pranayama, les shatkarmas, les mudras et les bandhas. Ce manuel sert de guide vers le samadhi et souligne l’importance d’un maître pour progresser sur le chemin du yoga.
Pour en savoir plus : lisez notre article blog sur le Hatha Yoga Pradipika.
I
Ida nadi
L’un des principaux canaux d’énergie (nadi) en yoga, situé au niveau de la colonne vertébrale. Associé à l’énergie mentale, au calme, à la narine gauche et à des qualités dites “lunaires” — d’où son autre nom, nadi lunaire.
Ishvara
Nom sanskrit désignant le Seigneur, ou la conscience suprême. Dans certaines écoles, Ishvara est un principe personnel — source de guidance, de grâce et d’ordre cosmique. Dans d’autres, il désigne simplement le Brahman en tant que conscience pure, sans attributs. Le concept varie selon les courants : dévotionnel, philosophique ou yogique.
J
Jnana yoga
Voie du yoga fondée sur la connaissance directe de la vérité ultime. Le jnana yoga repose sur le discernement (viveka) entre le réel et l’illusoire, et sur l’introspection profonde pour reconnaître que le Soi (atman) est un avec la conscience absolue (brahman). Il s’adresse à ceux qui cherchent l’éveil par l’étude, la réflexion et la réalisation intérieure.
Japa
Répétition d’un mantra, effectuée à voix haute, à voix basse (murmurée) ou mentalement. Le mantra japa est une technique méditative utilisée pour concentrer l’esprit et accéder à des états modifiés de conscience.
Jyotir
Mot sanskrit signifiant « lumière ». Dans la tradition yogique, il désigne à la fois la lumière spirituelle intérieure et les formes lumineuses perçues en méditation. Il symbolise aussi la clarté de la conscience.
K
Kaivalya
État de libération absolue décrit dans les Yoga Sutras de Patanjali. Le mot kaivalya signifie « isolement », « détachement total » ou « autonomie parfaite ». Il désigne l’état dans lequel la conscience pure (purusha) demeure en elle-même, totalement séparée de la matière (prakriti) et libre de toute identification avec le mental, les sens ou le corps.
Contrairement à moksha dans le Vedanta, qui insiste sur l’union avec le tout, kaivalya est défini dans le yoga classique comme une libération par la désidentification totale. C’est le but final du yoga selon Patanjali.
Karma yoga
Voie du yoga fondée sur l’action désintéressée. Le mot karma vient de kri (« faire »), et karma yoga signifie « union par l’action ». On agit sans attachement aux résultats, dans un esprit de service. Cette pratique purifie le mental, élargit la conscience et prépare à une sadhana plus profonde. Elle sert aussi à intégrer l’enseignement reçu du maître et à harmoniser l’énergie éveillée lors d’une pratique intense, notamment en retraite.
Mot relié : seva yoga
Kirtan
Pratique de bhakti yoga, le kirtan est le chant méditatif de mantras, souvent accompagné de musique. Par la répétition et l’abandon dans le chant, il mène naturellement à un état de méditation et de dévotion.
Mot relié : bhajan
Kosha
Les koshas sont les « enveloppes » ou « voiles » qui recouvrent la conscience véritable, selon la philosophie du yoga. L’univers – et l’être humain – est perçu comme constitué de couches entrecroisées, allant du plus grossier au plus subtil. Ces voiles masquent notre nature essentielle.
Les cinq koshas sont :
- Annamaya kosha – l’enveloppe du corps physique (faite de nourriture)
- Pranamaya kosha – l’enveloppe de l’énergie vitale (prana)
- Manomaya kosha – l’enveloppe mentale (pensées, émotions)
- Vijnanamaya kosha – l’enveloppe de l’intelligence intuitive ou de la sagesse
- Anandamaya kosha – l’enveloppe de la béatitude
Chaque kosha peut être abordée par des pratiques spécifiques de yoga visant à purifier et intégrer ces différentes dimensions de l’être.
Kriya
Terme sanskrit générique signifiant « action », « processus » ou « pratique ». En yoga, le mot kriya désigne souvent une technique ou une séquence d’actions visant un effet spécifique.
Kriya yoga
Forme de yoga avancé fondée sur l’utilisation de mudras, de pranayama et de visualisations, visant à éveiller la kundalini. Ce nom a été popularisé par Lahiri Mahasaya et sa lignée. De nombreuses traditions utilisent aujourd’hui le terme kriya yoga pour désigner leurs pratiques, bien que les méthodes varient.
Mot relié : kundalini yoga
Kumbhaka
Rétention du souffle dans le Hatha Yoga. On distingue trois formes principales :
– Antar kumbhaka : rétention à poumons pleins (après l’inspiration)
– Bahir kumbhaka : rétention à poumons vides (après l’expiration)
– Kevala kumbhaka : rétention spontanée, sans effort, qui survient dans des états avancés de pratique.
Kundalini
Énergie psychique latente en l’être humain, symbolisée par un serpent endormi au niveau du muladhara chakra. Le but du Hatha Yoga traditionnel est d’éveiller progressivement cette énergie afin qu’elle circule de manière harmonieuse dans les canaux subtils, nourrisse le système énergétique et induise une expansion de la conscience.
Kundalini kriya
Ensemble de techniques avancées issues du kriya yoga, visant à éveiller l’énergie de la kundalini. Ces kriyas combinent concentration (dharana), visualisation, gestes énergétiques (mudra), verrous corporels (bandha) et contrôle du souffle (pranayama). Elles font partie intégrante du hatha yoga traditionel.
L
Lota
Un lota, ou pot de neti, est un petit récipient conçu pour le lavage nasal. Utilisé dans la pratique du jala neti, il permet de rincer les narines avec de l’eau tiède salée, dans un but de purification yogique. Un lota peut contenir jusqu’à 500 ml d’eau et possède un bec adapté pour verser l’eau doucement dans une narine.
Pour en savoir plus : lisez notre article complet sur le neti.
M
Maha
Préfixe sanskrit signifiant « grand » ou « suprême ». Utilisé dans des mots comme mahasamadhi, mahatma ou mahamudra.
Mahasamadhi
Terme honorifique désignant la mort d’un yogi ou maître spirituel. Il implique, selon certaines traditions, que le pratiquant a quitté son corps en pleine conscience, en état de samadhi. Toutefois, le mot est souvent utilisé de manière plus symbolique ou respectueuse, sans impliquer une réalisation spirituelle ultime.
Mala
Rosaire utilisé en méditation pour compter les respirations, les répétitions de mantras (japa), ou d’autres pratiques. Traditionnellement composé de 108 perles, le mala aide à garder la concentration et à structurer la pratique spirituelle. Il est souvent fait de graines, de bois sacré (comme le tulsi ou le rudraksha), ou de pierres semi-précieuses.
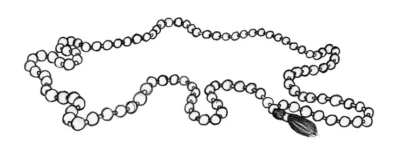
Manas
Mot sanskrit désignant le mental humain, ou faculté cognitive de base. Manas coordonne les impressions sensorielles, trie l’information et la transmet aux niveaux supérieurs de la conscience. Il est souvent décrit comme l’aspect réactif et conditionné de l’esprit.
Manipura chakra
Chakra située dans la colonne vertébrale derrière le nombril. Mot sanskrit signifiant « cité des joyaux ».
Mantra
Sons ou syllabes sacrés utilisés dans la tradition du yoga pour invoquer, concentrer l’esprit ou induire un état de conscience spécifique. Chaque mantra possède une vibration qui agit sur le mental et l’énergie. Ils peuvent être récités à voix haute ou répétés mentalement pendant la méditation.
Matrika
Les matrikas sont les syllabes fondamentales du langage mantrique. Le mot matrika signifie « petite mère ». Si la Grande Mère représente la totalité de l’univers et de la conscience, les matrikas en sont les aspects fragmentés — chaque état de conscience, chaque énergie ou archétype étant associé à une syllabe spécifique. Dans la tradition tantrique, chaque matrika est porteuse d’un pouvoir créateur et transformatif.
Mauna
Mot sanskrit signifiant « silence ». Employé comme pratique spirituelle, le mauna se retrouve dans plusieurs traditions, pas uniquement en Inde. Il consiste à s’abstenir de parler — parfois même de tout type de communication — pour cultiver l’intériorité, la clarté mentale et la sensibilité aux dimensions subtiles. Le mauna est souvent pratiqué lors de retraites ou d’initiations avancées en yoga.
Pour en savoir plus : lisez notre article complet sur le mauna.
Mitahara
Alimentation modérée et consciente, considérée comme essentielle à la discipline yogique dans les textes traditionnels.
Pour en savoir plus : lisez notre article sur la nourriture yogique.
Moksha
Libération spirituelle ultime dans la tradition du yoga et du Vedanta. Moksha signifie l’affranchissement définitif de l’ignorance, du cycle des renaissances (samsara) et de la souffrance. C’est l’état où le yogi réalise sa vraie nature comme étant sat-chid-ananda : être, conscience et félicité.
Moksha ne désigne pas un paradis ni une récompense, mais la libération intérieure, par la connaissance du Soi (atman) comme non séparé du tout (brahman). C’est le but ultime du yoga dans ses formes les plus traditionnelles.
Maya
Terme désignant le voile de l’illusion ou de l’apparence, surtout dans l’Advaita Vedanta. Maya donne l’illusion de la multiplicité, du changement et de la séparation, alors que seule la conscience absolue (brahman) est réellement existante. Elle n’est pas simplement fausse, mais transitoire, dépendante et trompeuse — elle masque la réalité ultime tout en la manifestant.
Muladhara chakra
Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, juste au-dessus du périnée. Le mot mula signifie « racine » et adhara, « support ». Associé à l’élément terre, il représente la stabilité, la sécurité et l’ancrage. C’est également dans ce centre que réside l’énergie kundalini à l’état latent, selon la tradition yogique.
Murti
Représentation physique ou image d’une divinité, utilisée comme support de dévotion dans les traditions hindoues et yogiques. La murti peut être une statue, une icône ou une image, considérée comme une manifestation vivante du divin lorsqu’elle est consacrée.
Le mot murti peut également entrer dans la composition d’un nom spirituel, indiquant que la personne est perçue comme l’incarnation d’une qualité yogique, par exemple Anandamurti – « manifestation de la félicité ».
N
Nada yoga
Pratique de Hatha Yoga fondée sur la concentration sur les sons intérieurs (ou nada). Le nada yoga utilise le son comme support de méditation, menant progressivement l’esprit vers la concentration et des états de conscience profonds.
Pour en savoir plus : lisez notre article complet sur le nada yoga.
Nadi
Les nadis sont les canaux énergétiques du corps subtil, à travers lesquels circule le prana (l’énergie vitale). Ils se croisent dans les centres psychiques appelés chakras. Selon certaines traditions yogiques, le corps humain posséderait 72 000 nadis, voire 7 272 311 dans des descriptions plus ésotériques. Les trois principaux sont ida, pingala et sushumna.
Natha
Tradition yogique apparue vers le Xe siècle, fondée autour de figures comme Matsyendranath et Gorakhnath. Le mot natha signifie « seigneur » ou « maître ». Les Natha yogis ont joué un rôle majeur dans l’élaboration du Hatha Yoga classique, tel qu’il est décrit dans les textes anciens.
Leur approche, influencée par le tantra, mettait l’accent sur l’éveil de la kundalini, la maîtrise de l’énergie vitale et la réalisation spirituelle dans le corps vivant. La transmission se faisait hors des structures brahmaniques, par l’initiation directe du guru au disciple.
Aujourd’hui, bien que les Natha subsistent comme tradition vivante, la pratique du Hatha Yoga dans son sens technique n’y occupe plus qu’une place marginale.
Mot relié : sampradaya
Neti
Technique de purification du nez, faisant partie des shat karmas (pratiques de nettoyage) du hatha yoga. Il existe deux formes principales :
– Jala neti : nettoyage des narines à l’eau tiède salée, à l’aide d’un lota (pot de neti).
– Sutra neti : utilisation d’un fil souple (traditionnellement en coton ou caoutchouc) enduit de cire pour nettoyer les conduits nasaux.
Bien que liée au hatha yoga, la pratique du neti est également reconnue en médecine traditionnelle et en hygiène respiratoire moderne.
Pour en savoir plus : lisez notre article complet sur le neti.
Niyama
Les niyamas sont des disciplines personnelles visant à créer un cadre intérieur propice à la pratique du yoga. Il ne s’agit pas de règles morales, mais de stratégies concrètes pour transformer son mode de vie.
Les cinq niyamas, tels que définis par Patanjali dans les Yoga Sutras, sont :
– Sauca : pureté (du corps et de l’esprit)
– Santosha : contentement
– Tapas : discipline, ferveur intérieure
– Svadhyaya : étude de soi-même et des textes sacrés
– Ishvara Pranidhana : abandon au principe divin
O
Om
Om est un mantra fondamental, considéré comme la vibration primordiale de l’univers. De nombreux mantras commencent par Om, car il symbolise la conscience absolue. Il est utilisé pour centrer l’attention et élever la conscience.
P
Padma
Mot sanskrit signifiant « lotus », symbole classique de l’épanouissement spirituel. Le lotus pousse dans la boue mais s’élève au-dessus de l’eau pour fleurir, représentant ainsi la possibilité d’atteindre la pureté et la réalisation, même à partir des conditions les plus ordinaires.
Paramahamsa
Titre honorifique désignant un maître spirituel pleinement réalisé. Littéralement « grand cygne », symbole de pureté et de capacité à distinguer le réel de l’irréel. Il évoque un être qui traverse le monde sans s’y attacher, en toute liberté.
Parampara
Transmission ininterrompue d’un enseignement spirituel au sein d’une lignée. Le mot signifie littéralement « de l’un à l’autre en succession ». Il désigne la continuité vivante entre maître (guru) et disciple (shishya), assurant la fidélité à une tradition. Dans le yoga, le parampara garantit la profondeur et l’authenticité des pratiques transmises.
Mot relié : sampradaya
Patanjali
Sage indien traditionnellement reconnu comme l’auteur des Yoga Sutras, un texte fondamental de l’Ashtanga Yoga, le yoga à huit membres. Selon la légende, il aurait formulé ces aphorismes en quelques heures. La plupart des chercheurs situent sa vie autour du IIIe ou IVe siècle de notre ère.
Pingala nadi
Canal d’énergie (nadi) situé au niveau de la colonne vertébrale, associé à la force vitale dynamique, à l’énergie solaire et à l’activité physique. Pingala est relié à la narine droite et complète ida nadi, dans un équilibre entre énergie active et réceptive.
Prana
Énergie vitale ou force de vie qui anime le corps et l’esprit. Prana circule dans les nadis et soutient toutes les fonctions vitales : respiration, pensée, digestion, mouvement. Dans le modèle des koshas, prana constitue la seconde enveloppe après le corps physique. En yoga, les techniques comme le pranayama visent à à renforcer le prana et ouvrir l’accès à des états de conscience supérieurs.
Pranavidya
Méditation avancée et technique d’auto guérison dans le système du yoga de Swami Satyananda Saraswati. C’est une méthode pour faire circuler le prana qui se pratique normalement allongé sur le dos.
Pranayama
Méthode phare du hatha yoga souvent traduite par « exercices de respiration ». Le mot pranayama vient de prana (énergie vitale, souffle) et ayama (extension, expansion, étirement). Il désigne ainsi l’expansion ou la régulation du souffle et de l’énergie vitale.
Le pranayama vise à purifier les nadis (canaux énergétiques subtils), à élever le niveau de prana dans le corps, et à préparer le mental aux états méditatifs profonds. Il constitue une étape essentielle avant les pratiques avancées du yoga.
Pratyahara
Retrait des sens ou suspension des perceptions sensorielles. Pratyahara signifie littéralement « retrait de ce qui est absorbé », c’est-à-dire des impressions venues de l’extérieur. Cette pratique marque la transition entre le yoga extérieur (asana, pranayama, mudra, bandha) et le yoga intérieur (concentration, méditation).
Pour en savoir plus : Lisez l’article complet sur le pratyahara.
R
Raga
Attachement ou attrait envers les expériences perçues comme agréables. Dans la philosophie du yoga (notamment exposée dans les Yoga Sutras de Patanjali), raga est identifié comme l’un des cinq kleshas, c’est-à-dire les causes fondamentales de la souffrance. Il naît du souvenir du plaisir et du désir de le reproduire.
Raja yoga
Raja Yoga, la « voie royale », désigne un système de yoga médiéval centré sur la méditation sans effort et l’attention ouverte. Il a été codifié dans l’Amanaska, un texte sanskrit du XIᵉ siècle. Ce yoga met l’accent sur la contemplation silencieuse plutôt que sur des techniques corporelles complexes, et se veut accessible à tous.
À ne pas confondre avec l’Ashtanga Yoga de Patanjali, que certains enseignants modernes appellent également Raja Yoga — bien qu’il s’agisse d’un système différent, fondé sur huit étapes progressives.
S
Sadhana
Le sadhana est l’ensemble des pratiques, disciplines et stratégies personnelles mises en œuvre pour progresser sur le chemin du yoga. Il peut inclure des techniques comme l’asana, le pranayama, la méditation, le mantra, le service désintéressé ou l’étude spirituelle. Le sadhana est souvent adapté à chaque individu, en fonction de ses besoins, de sa tradition et de son niveau. Il représente l’engagement régulier vers la transformation intérieure et la réalisation du Soi.
Sadhaka
Pratiquant engagé sur la voie spirituelle, dans le sadhana. Un sadhaka s’engage dans une discipline yogique, en vue de la réalisation du Soi ou d’un but yogique spécifique. Le terme désigne autant un débutant sincère qu’un chercheur expérimenté, selon le contexte.
Sadhu
Un sadhu est souvent un renonçant ou un ascète qui consacre sa vie à la pratique du sadhana (discipline spirituelle) en vue de la libération. Les sadhus peuvent vivre dans des ashrams, dans la nature ou dans les lieux saints, et sont parfois rattachés à une tradition monastique ou initiatique.
Le terme peut désigner aussi bien un homme qu’une femme (sadhvi pour la forme féminine), et englobe une grande diversité de styles de vie, du moine itinérant au méditant retiré.
Mots reliés : yogi, sadhaka, baba, swami
Sahasrara chakra
Le sahasrara chakra est le centre énergétique situé au sommet du crâne. Également appelé « centre aux mille pétales », il symbolise la conscience pure, l’union avec le divin et l’éveil spirituel ultime. Dans la tradition du Hatha Yoga, il représente le point de fusion entre l’énergie individuelle (kundalini) et la conscience cosmique.
Samadhi
Samadhi est un état avancé de méditation dans lequel le mental devient parfaitement silencieux et absorbé, et où la conscience remplit entièrement l’esprit. Dans cet état, la dualité entre l’observateur, l’observé et l’acte d’observer disparaît.
Samkhya
Système philosophique indien ancien, considéré comme l’un des six darshanas (écoles orthodoxes). Le Samkhya distingue deux réalités fondamentales : purusha (la conscience pure) et prakriti (la nature, la matière). C’est un dualisme métaphysique dans lequel la libération survient par la connaissance discriminative entre ces deux principes. Cette école a profondément influencé le Yoga Classique de Patanjali.
Samsara
Cycle des naissances, morts et renaissances auquel est soumis tout être vivant tant qu’il n’a pas atteint la libération spirituelle (moksha). Samsara est gouverné par le karma, les actions passées influençant les renaissances futures. Il est vu comme une condition de souffrance et d’ignorance, que le yoga et d’autres voies spirituelles cherchent à transcender.
Pour en savoir plus : Lisez notre article complet sur la réincarnation et le yoga.
Samskara
Empreinte mentale laissée par une expérience, une action ou une pensée. Les samskaras résident dans le chitta et influencent nos réactions, désirs et schémas inconscients. Ils façonnent notre personnalité et nos conditionnements. Le yoga vise à purifier ces impressions pour libérer la conscience. Certains samskaras peuvent être bénéfiques, d’autres limitants ou source de souffrance.
Sampradaya
Tradition spirituelle structurée autour d’un corpus d’enseignements, d’une lignée (parampara) et d’une interprétation particulière des textes. Un sampradaya transmet une vision cohérente du yoga ou de la philosophie, souvent rattachée à un maître fondateur. Il peut être philosophique (Advaita), tantrique (Kaula) ou yogique (Natha).
Sanatana dharma
Expression signifiant « loi éternelle » ou « ordre éternel ». Utilisée pour désigner l’ordre cosmique, moral et spirituel qui sous-tend l’univers. Elle fait référence à une vérité intemporelle, à la fois métaphysique et éthique, considérée comme la base de la pratique du yoga, du dharma, et de la voie spirituelle. Le terme est parfois utilisé pour désigner l’hindouisme traditionnel.
Sankalpa
Intention profonde ou résolution intérieure, souvent formulée en début de pratique spirituelle, notamment dans le yoga nidra. Elle exprime une direction claire de transformation ou de réalisation personnelle.
Sannyasa
Renonciation radicale au monde ordinaire et aux aspirations personnelles, en vue d’une vie entièrement consacrée à la quête spirituelle. Dans la tradition du yoga, le sannyasa implique l’abandon des attachements, des rôles sociaux, des possessions et du Soi imaginaire, afin de retrouver sa vraie nature. Il marque une rupture nette avec les obligations mondaines et correspond à une voie exigeante, orientée vers la libération (moksha).
Sannyassin
Personne ayant pris le sannyasa, c’est-à-dire renoncé au monde ordinaire et à ses attachements pour se consacrer pleinement à la quête spirituelle. Le sannyassin abandonne les rôles sociaux, les possessions et les désirs personnels dans le but de réaliser sa vraie nature.
Sat-chid-ananda
Expression sanskrite composée de trois termes :
– Sat : l’Être pur, la réalité absolue ou la vérité immuable
– Chid (ou chit) : la conscience, la connaissance
– Ananda : la félicité, la béatitude sans cause
Sat-Chid-Ananda désigne la nature essentielle du Soi (atman) ou de la réalité ultime (Brahman), telle que décrite dans les Upanishads et les enseignements du Vedanta. Ce n’est pas un état émotionnel, mais une expérience directe de l’absolu : être pur, conscience pure et joie inaltérable.
Satsang
Mot sanskrit signifiant « association avec la vérité » (sat = vérité, réalité absolue ; sanga = compagnie, contact). Dans la tradition spirituelle de l’Inde, le satsang désigne une rencontre entre un chercheur sincère et un maître réalisé, généralement sous forme de dialogue direct, question–réponse, centré sur la connaissance de soi (atma-jnana) et la libération (moksha).
Ce sens traditionnel ne doit pas être confondu avec les formes modernes de satsang incluant chant et méditation de groupe, qui en sont des extensions contemporaines.
Satya
Mot sanskrit signifiant « vérité » ou « réalité essentielle ». Satya désigne à la fois la vérité en parole — dire ce qui est — et la vérité ontologique, c’est-à-dire la fidélité à la réalité profonde des choses. Dans la tradition du yoga, satya est l’un des yamas (principes éthiques) énoncés par Patanjali, et implique une parole juste, alignée avec l’intention pure et la non-nuisance.
Seva yoga
Le yoga du service désintéressé, très proche du karma yoga dans son essence. Seva signifie « service », et désigne ici l’action offerte sans attente de récompense, comme expression de dévotion et de purification intérieure.
Pratique centrale dans de nombreuses traditions spirituelles, le seva yoga permet de transcender les préoccupations personnelles et d’atténuer l’ego, en mettant l’énergie au service du bien commun. C’est aussi une forme d’apprentissage, où le disciple (chela) intègre les enseignements du maître en travaillant pour et avec lui dans un esprit de dévouement.
Shakti
L’énergie dans toutes ses formes — créatrice, transformative, dynamique. Dans la tradition du yoga et du tantra, shakti est le principe actif de l’univers, la puissance qui manifeste les phénomènes. Elle représente le pôle féminin de la réalité, en complément de Shiva, principe de conscience immobile.
Sur le plan mythologique, Shakti est personnifiée par des déesses comme Durga, Kali, Parvati ou Saraswati. Sur le plan intérieur, elle est l’énergie vitale présente en chaque être, notamment sous la forme de la kundalini, endormie dans le muladhara chakra.
Shakti pat
Transmission directe d’énergie spirituelle d’un maître à un disciple. Le terme vient de shakti (énergie, puissance) et pat (chute, descente). Le shakti pat peut provoquer l’éveil de la kundalini ou une transformation intérieure profonde. Cette transmission peut être intentionnelle ou spontanée, par un regard, un mot, un geste, ou même en silence.
Dans les traditions tantriques, notamment dans le kundalini yoga et les lignées non-duelles comme le kashmir shaivisme, le shakti pat est considéré comme un moment décisif sur le chemin spirituel — une grâce transmise qui dépasse les efforts personnels.
Shankprakshalana
Shankprakshalana est une technique traditionnelle de purification yogique visant à nettoyer en profondeur tout le système digestif. Elle consiste à boire de l’eau chaude salée en suivant une série précise de mouvements pour favoriser l’évacuation complète des intestins.
Le terme signifie littéralement « grand nettoyage de la conque », en référence au passage de l’eau à travers le corps comme dans une conque. Cette pratique, issue des shat karma du hatha yoga, vise à éliminer les toxines, à lever les blocages énergétiques dans le ventre, et à préparer le corps et le mental à un sadhana avancé.
Elle est parfois utilisée comme soutien thérapeutique naturel chez les personnes souffrant de troubles digestifs ou de déséquilibres métaboliques comme le diabète.
Shat karma
Dans le Hatha Yoga, les shat karmas sont les six techniques majeures de purification du corps. Le terme signifie littéralement « six actions » (shat = six, karma = action). Ces pratiques visent à préparer le corps à des formes avancées de yoga en éliminant les toxines et en équilibrant les énergies.
Les six shat karmas classiques sont :
– Tratak : fixation du regard pour purifier les yeux et stabiliser le mental
– Kapalabhati : souffle rapide pour nettoyer les sinus et clarifier l’esprit
– Dhauti : nettoyage de l’œsophage et de l’estomac
– Neti : lavage des voies nasales
– Basti : lavement yogique
– Nauli : massage abdominal par rotations musculaires
Shishya
Disciple engagé dans une relation de transmission avec un guru. Le shishya reçoit l’enseignement spirituel au sein d’une tradition (parampara) et s’implique avec respect, confiance et discipline. Ce lien est central dans le yoga classique comme dans les voies tantriques.
Mot relié : chela
Shiva
Dans la mythologie du yoga et les traditions tantriques, Shiva représente l’incarnation de la conscience pure, immobile et intemporelle. Il est le pôle complémentaire de Shakti, l’énergie créatrice manifestée. Ensemble, ils symbolisent l’union de la conscience et de l’énergie — principe fondamental dans le yoga traditionnel.
Shiva n’est pas seulement une divinité mythologique, mais l’expression de la nature ultime de l’être : silencieuse, consciente et libre.
Siddhi
Pouvoir ou capacité supranaturelle acquise par la pratique avancée du yoga, notamment par le pranayama, la méditation profonde ou la concentration intense (dharana). Les siddhis peuvent inclure la clairvoyance, la télépathie, la lévitation, la connaissance intuitive, ou une force physique exceptionnelle.
Selon les textes ancestrales, les siddhis sont parfois présentés comme des effets secondaires naturels de la concentration, parfois comme des buts en soi. Toutefois, de nombreux maîtres insistent sur le fait qu’ils peuvent devenir des obstacles et un détournent de la réalisation ultime.
Sushumna
Canal énergétique central (nadi) situé dans l’axe de la colonne vertébrale. Sushumna relie les chakras principaux, du muladhara chakra (à la base) jusqu’au sahasrara chakra (au sommet du crâne). Selon certaines traditions yogiques, c’est par ce canal que l’énergie kundalini, une fois éveillée, s’élève en traversant les différents centres psychiques.
Dans le Hatha Yoga et le tantra, l’ouverture et la purification de sushumna sont considérées comme essentielles pour accéder aux états méditatifs profonds et à la réalisation de la vérité ultime.
Svatmarama
Yogi indien du XVe siècle, auteur du Hatha Yoga Pradipika, un texte fondamental du hatha yoga. Peu d’éléments biographiques sont connus, mais son œuvre a profondément structuré la tradition en exposant de manière claire les pratiques d’asana, pranayama, mudra et samadhi. Son nom signifie « celui qui se réjouit dans le soi ».
Swadhisthana chakra
Le swadhisthana chakra est le deuxième chakra du système yogique classique. Il est situé au-dessus du muladhara chakra, dans la région du sacrum. Son nom signifie littéralement « demeure du soi » (swa = soi, adhisthana = demeure).
Swami
Mot sanskrit signifiant « maître de soi » ou « seigneur de soi-même ». Dans la tradition du yoga, swami est un titre spirituel attribué à une personne ayant renoncé à la vie mondaine (sannyasa) pour se consacrer à la quête de la réalisation spirituelle et de la maîtrise intérieure.
Le titre est utilisé dans plusieurs lignées, notamment dans l’Advaita Vedanta et l’ordre des dix noms (Dashnami Sampradaya), fondé par Adi Shankaracharya. Ce titre est généralement suivi d’un nom spirituel donné lors de l’initiation, suivi de Swami (par exemple : Swami Sivananda, Swami Niranjanananda).
Mots reliés : baba, guru
Pour en savoir plus : lisez l’article « Cela veut dire quoi d’être Swami«
T
Tantra
Méta-système spirituel issu de l’Inde ancienne, qui articule l’union de la conscience (shiva) et de l’énergie (shakti). Le tantra est une approche intégrative qui inclut l’invocation, le rituel, le mantra, la méditation et les pratiques yogiques, dans le but de transcender la dualité et d’atteindre des états supérieurs de conscience, de transformation et de libération.
Le tantra sacralise tous les aspects de la vie — y compris le corps, les émotions et le monde — les considérant comme des voies potentielles d’éveil spirituel. Des concepts clés du Hatha Yoga, comme les chakras et la kundalini, sont hérités des traditions tantriques. Il a profondément influencé plusieurs courants, dont le haṭha yoga, le shivaïsme du Cachemire, et certaines formes de bouddhisme tantrique.
Pour en savoir plus : lisez notre article complet sur le Tantra.
Tapasya
Ascétisme volontaire et discipline spirituelle intense. Le mot tapasya vient de tapas, qui signifie « chaleur », symbolisant l’effort intérieur qui brûle les impuretés. Dans la tradition yogique, cela peut aller de pratiques austères modérées (jeûne, silence, veilles, isolement) à des formes extrêmes : rester debout des années, lever un bras en permanence, ou méditer dans des conditions rigoureuses.
Par ces épreuves, le pratiquant dépasse le confort, le plaisir et la souffrance. Tapasya donne un éclairage essentiel sur le yoga : il ne s’agit pas d’une simple recherche de bien-être, mais d’une voie de transformation profonde, exigeante, et spirituelle.
Tattwa
Mot sanskrit signifiant littéralement « principe », « réalité » ou « essence ». Dans la tradition du yoga, du tantra et du Samkhya, les tattwas désignent les éléments fondamentaux de la manifestation.
Les cinq tattwas élémentaires sont :
– Prithvi : la terre
– Apas : l’eau
– Tejas : le feu
– Vayu : l’air
– Akasha : l’espace ou l’éther
Ces cinq éléments sont considérés comme les bases subtiles de toute forme physique et énergétique. Dans certaines pratiques yogiques (pranayama, mudra, bandha, kundalini), les tattwas sont équilibrés ou transcendés pour accéder à des niveaux supérieurs de conscience.
Tattwa shuddhi
Méditation ou méthode de purification des éléments dans le système de yoga de Swami Satyananda Saraswati.
TM (Transcendental Meditation)
La Méditation Transcendantale est une méthode de méditation mantra introduite par Maharishi Mahesh Yogi dans les années 1950. Elle consiste à répéter silencieusement un mantra personnel, dans le but de calmer le mental et de transcender l’activité mentale ordinaire.
TM est l’un des premiers exemples d’une adaptation standardisée du yoga pour le grand public occidental. Présentée comme laïque et accessible, elle a connu un grand succès mondial. Toutefois, le mouvement a aussi été critiqué, notamment pour ses tarifs élevés, son système fermé, et certaines affirmations exagérées concernant ses effets.
Tratak
Technique de concentration (dharana) dans laquelle le regard est fixé, sur un objet précis — souvent la flamme d’une bougie. Le support peut aussi être un point noir, un yantra, un symbole sacré ou le reflet de la lune.
Lorsque tratak est pratiqué jusqu’à la production de larmes, il devient une méthode de purification visuelle, classée parmi les shat karmas du hatha yoga. Cette pratique stabilise le mental, purifie les yeux et prépare l’esprit à la méditation profonde en détournant l’attention des stimuli extérieurs.
U
Ujjayi pranayama
Le mot ujjayi vient du sanskrit ud (au-dessus, élever) et ji (conquérir, vaincre), ce qui donne « le victorieux » ou « celui qui triomphe ». Ainsi, ujjayi pranayama peut se traduire littéralement par « souffle victorieux ».
C’est un pranayama méditatif dans lequel on respire avec un léger chuchotement continu dans la gorge. Cette technique calme le mental, allonge la respiration et favorise l’intériorisation.
Dans certaines formes de kriya yoga, ujjayi pranayama joue un rôle important et peut être désigné sous le nom de kriya pranayama ou de respiration psychique, en raison de ses effets subtils sur les plans énergétiques et mentaux.
Upanishad
Textes spirituels anciens formant la partie finale des Veda et constituant le fondement de la philosophie du Vedanta. Les Upanishads développent l’idée de l’unité entre le Soi individuel (atman) et la réalité absolue (brahman), marquant un tournant vers une quête intérieure, au-delà du ritualisme védique.
Les premières formulations philosophiques et techniques du yoga — discipline mentale, concentration, libération (moksha) — apparaissent clairement dans des textes comme la Brihadaranyaka ou la Chandogya, datés entre 700 et 500 av. J.-C. On recense traditionnellement 108 Upanishads, bien que certaines aient été composées jusqu’au XVIIe siècle.
V
Vairagya
Non-attachement. Attitude intérieure de détachement vis-à-vis des objets des sens, des désirs et des résultats des actions. Vairagya ne signifie pas indifférence, mais clarté et liberté intérieure face à l’attraction ou à la répulsion. C’est une qualité fondamentale dans le yoga.
Vedanta
Système philosophique majeur de l’Inde ancienne, fondé sur les enseignements des Upanishads. Le mot vedanta signifie littéralement « fin du Veda » et désigne à la fois les textes les plus tardifs des Védas et leur interprétation métaphysique. Le Vedanta enseigne que l’âme individuelle (atman) est en réalité identique à l’absolu (brahman). Il existe plusieurs écoles de Vedanta, dont l’Advaita (non-dualisme), le Vishishtadvaita (non-dualisme qualifié) et le Dvaita (dualisme).
Vibhuti
Mot sanskrit ayant deux significations principales dans la tradition indienne :
- Cendre sacrée utilisée dans les rituels hindous, notamment dans le shivaïsme. Appliquée sur le front ou le corps, elle symbolise la purification, le détachement et la conscience de l’impermanence.
- Pouvoir surnaturel ou manifestation divine, tel que décrit dans les Yoga Sutras de Patanjali et la Bhagavad Gita. Dans ce sens, vibhuti désigne les capacités extraordinaires manifestées par une conscience hautement purifiée.
Mot relié : siddhi
V
Vigyana
Mot sanskrit désignant l’intelligence intuitive, ou connaissance directe qui dépasse le raisonnement intellectuel. Vigyana combine vi (distinction, clarté) et jnana (connaissance). Il s’agit d’une forme de compréhension profonde, spontanée et intégrée, liée à l’expérience intérieure plutôt qu’à l’analyse mentale.
Vishuddhi chakra
Vishuddhi chakra est décrit dans les textes traditionnels, comme le Shat Chakra Nirupana, comme un lotus à seize pétales situé dans la région de la gorge. Il est associé à l’élément éther (akasha), au bija mantra HAM, et à la déesse Shakini.
Le nom vishuddhi signifie « purification parfaite », et indique que ce centre est lié au raffinement des énergies subtiles.
Selon certaines traditions, un nectar divin (amrita) s’écoule depuis le bindu visarga, un centre situé au sommet de la tête. Ce nectar descend vers le vishuddhi chakra, où il peut être purifié et conservé.
Vishuddhi shuddhi
Méditation dans le système de Swami Satyananda, quelque fois nommée la Source d’Energie. Cette méditation constitue une première étape vers le kriya yoga.
Viveka
Capacité de discernement spirituel. Viveka désigne l’aptitude à distinguer ce qui est réel (sat) de ce qui est illusoire ou impermanent (asat). C’est une qualité centrale dans le Jnana Yoga et la voie de la connaissance.
Y
Yama
Les yamas sont des restrictions que le yogi s’impose à lui même pour faciliter son parcours yogique. Il s’agit de stratégie et non pas de moral.
Les cinq yamas de Patanjali sont :
Ahimsa : ne pas faire de mal
Satya : ne pas mentir
Asteya : ne pas voler
Brahmacharya : utiliser l’énergie vitale à bon escient
Aparigraha : ne pas être avare
Yantra
Figure géométrique utilisée comme support rituel et méditatif dans les traditions du tantra. Le yantra peut être tracé matériellement (sur métal, papier, ou sol) ou visualisé mentalement. Il sert à concentrer le mental, à canaliser les énergies subtiles et à mettre en relation avec une puissance cosmique ou une déité.
Chaque yantra correspond à une structure énergétique précise, souvent centrée autour d’un point (bindu), et composée de formes symboliques (triangles, cercles, lotus, carrés) disposées selon une logique sacrée. Son usage exige souvent une initiation et s’inscrit dans des pratiques codifiées de mantra et de puja.
Yatra
Dans la tradition du yoga, un yatra (mot sanskrit signifiant « voyage » ou « pèlerinage ») désigne un déplacement sacré, souvent vers un lieu saint comme un temple, une montagne, une rivière ou un site associé à une divinité ou à un grand maître spirituel.
Yoga
Le mot yoga vient de la racine sanskrite yuj, qui signifie « lier », « atteler » ou « unir ». Cependant, ce que le yoga unit dépend des traditions. Pour certaines écoles, il s’agit de l’union entre l’âme individuelle (atman) et l’absolu (brahman) ; pour d’autres, c’est l’arrêt des activités mentales ou la fusion de la conscience et de l’énergie.
Au-delà de ce but d’union, le mot yoga désigne aussi un chemin de transformation, fondé sur des méthodes spécifiques : postures (asana), respiration (pranayama), méditation, mantras, service désintéressé, etc. Il existe plusieurs voies de yoga, chacune mettant l’accent sur des aspects différents de cette quête intérieure.
Yoga classique
Terme utilisé, notamment en milieu académique, pour désigner le yoga exposé dans les Yoga Sutras de Patanjali, centré sur la méditation et la libération de la conscience (kaivalya).
Mots reliés : Ashtanga Yoga, samkhya
Yoga kundalini
Le yoga kundalini est, dans son sens traditionnel, pratiquement synonyme du Hatha Yoga tel qu’enseigné dans les textes anciens. Son objectif central est l’éveil de kundalini, l’énergie spirituelle latente à la base de la colonne vertébrale. Cette énergie est conduite à s’élever dans le canal central appelé sushumna nadi, en traversant les centres psychiques (chakras) jusqu’à l’union avec la conscience suprême.
À ne pas confondre avec le Yoga kundalini tel qu’enseigné par Yogi Bhajan au XXe siècle, qui constitue un mouvement moderne distinct, avec une approche très différente de celle des textes classiques du yoga.
Yoga nidra
Le yoga nidra, ou « sommeil yogique », est une technique de relaxation profonde systématisée par Swami Satyananda Saraswati au début des années 1960. Il s’inspire à la fois de pratiques méditatives issues du tantra ancien et des méthodes modernes de relaxation occidentale.
Yoga Sutras
Les Yoga Sutras sont un texte du yoga classique, attribué au sage Patanjali et probablement rédigé entre le IIᵉ siècle avant notre ère et le Ve siècle de notre ère. S’inscrivant dans le cadre philosophique du Samkhya, ce traité peut également être lu comme une réponse implicite aux doctrines bouddhiques alors en plein essor.
Comptant 195 aphorismes, le texte est dense et souvent difficile d’accès sans commentaire. Il expose une voie spirituelle rigoureuse appelée ashtanga yoga (« yoga en huit membres »), dont le but est la cessation des fluctuations du mental (citta-vritti-nirodha) afin de permettre l’isolement de la conscience pure (purusha) — un état appelé kaivalya.
Le texte a profondément influencé la vision moderne du yoga, même si son impact fut relativement limité dans certaines traditions médiévales. Son interprétation a varié selon les écoles et les contextes historiques.
Yuga
Les yuga (ou yougas, en français translittéré) sont les grands âges cycliques de la cosmogonie du sanatana dharma (l’ordre éternel), tels que décrits dans les traditions védiques et puraniques. Il en existe quatre, formant un cycle appelé mahayuga : le Satya Yuga (âge de vérité), le Treta Yuga, le Dvapara Yuga, et enfin le Kali Yuga, l’âge de fer.
Nous vivons actuellement dans le Kali Yuga, un âge sombre caractérisé par la confusion, la perte des repères spirituels et l’éloignement de l’ordre naturel et divin. Selon cette vision cyclique du temps, le Kali Yuga finira par s’épuiser, et l’humanité entrera progressivement dans une phase de renouveau spirituel, revenant peu à peu vers le Satya Yuga, l’âge de la vérité et de l’harmonie.
Abonnez-vous à notre newsletter
Soyez tenus au courant de nos actualités.